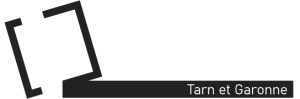Dans le bureau du colonel Akil, au 17e Régiment du Génie Parachutiste, le général Arnaud de Richoufftz prend place sans cérémonie. Pas de protocole pesant, juste la sobriété de celui qui connaît l’Arme depuis l’intérieur, depuis longtemps.
Il n’était encore jamais venu au 17e RGP. L’occasion s’est imposée, presque naturellement, à la fois comme “Père de l’Arme du Génie” chargé de superviser tous les régiments, et comme officier revenu dans une maison où il a été formé, puis où il a formé d’autres.
« Visiter les régiments fait partie de mes missions. Comprendre leurs réalités, voir leurs sujets de fond, assurer la cohérence de l’Arme. Et puis… je n’avais jamais visité le 17e. » Le ton est simple, direct, sans détour.
Un retour aux sources
Le général n’a rien oublié de son entrée à l’École du Génie, à Angers, où il commence comme aspirant avant d’y revenir lieutenant, après son passage à Coëtquidan. De poste en poste, il traverse les responsabilités habituelles : instruction, opérations, commandement. Aujourd’hui, il dirige cette même école, devenue l’un des lieux stratégiques de l’Armée de terre pour préparer l’avenir.
Son regard est marqué par ce parcours très opérationnel : « Les formations reçues et mon parcours de responsabilité, surtout opérationnel, me permettent d’insuffler un élan et une direction avec un regard un peu neuf qui me sert pour questionner beaucoup de sujets. » Un regard utile, à un moment où le Génie change vite — peut-être plus vite que jamais.
Une Arme plongée dans de nouvelles exigences
À Angers, l’école du Génie ne se contente plus de former : elle pense, elle analyse, elle irrigue les unités. C’est un centre d’analyse et d’anticipation. Les transformations sont rapides : numérisation, robotisation, drones, restructurations, nouveaux matériels. Les régiments voient arriver des équipements en quantité, et ce mouvement va durer encore une décennie.
Le général en parle avec prudence mais clarté : l’école doit autant anticiper qu’écouter.Certaines innovations naissent dans les unités, parfois à Montauban, parfois ailleurs ; l’école les récupère, les compare, les assemble, puis transmet plus largement. Une idée locale peut devenir une méthode nationale. Cette circulation de savoir-faire est aujourd’hui l’un des moteurs silencieux du Génie.
Un champ de bataille qui ne ressemble plus à ce qu’il était
Quand le général évoque les engagements actuels, sa voix devient plus grave. Pas alarmiste, mais lucide.
Le monde change, les conflits aussi. « Aujourd’hui, il y a une complexité du champ de bataille. Quand on regarde ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, ou ailleurs, on voit qu’aujourd’hui un officier est confronté à énormément d’informations et de menaces, et à un environnement très complexe.»
Il décrit ce contraste devenu symbole des guerres contemporaines : « L’exemple de l’Ukraine nous le montre, on est dans une guerre qui est à la fois extrêmement technologique, et extrêmement rustique, j’allais dire à l’ancienne. On a du combat de tranchées comme en 18, avec des drones ultramodernes qui volent au-dessus, donc c’est ce paradoxe qu’il faut arriver à apprendre à nos jeunes officiers, sous-officiers.»
Ce paradoxe impose un bouleversement dans la manière de préparer les cadres du Génie. Plus question de former uniquement à des opérations ciblées ou choisies. L’incertitude est devenue la matière première de l’enseignement. « On ne peut plus se préparer de manière aussi ciblée à ces engagements, mais on doit, au contraire, préparer, notamment nos officiers, à développer leurs capacités. On doit les préparer à s’adapter, à avoir la capacité d’adaptation, de réaction, à des environnements qui sont extrêmement variés et pour lesquels on ne peut pas intégralement les préparer, et couvrir le champ global de ce qu’ils auront à affronter.»
Soldat, sapeur, spécialiste — et dans cet ordre
Malgré les mutations, le général reste attaché à une hiérarchie immuable : d’abord le soldat, ensuite le sapeur, et seulement après le spécialiste. « Nous sommes des soldats. Soldat rustique, sachant utiliser son arme, sachant combattre. Sapeur, au profit de l’ami, ou au profit de l’ennemi sur un champ de bataille et ensuite spécialiste, électromécanicien, parachutiste, etc.» Dans un monde où tout s’accélère, ce socle demeure.
Une armée qui recrute… et qui attire
Là où beaucoup d’armées européennes peinent à remplir leurs rangs, l’armée française atteint ses objectifs. Le général ne s’en satisfait pas : il s’en sert pour encourager. « J’encourage tous les jeunes à venir s’engager, soit en tant que militaire du rang, sous-officier, officier, en activité, pour contribuer à la défense de notre pays. On voit bien les menaces qui pèsent, elles sont réelles, et il faut s’y préparer. »
Et il insiste : « Ils y découvriront des valeurs fortes de défense de l’intérêt commun, de défense de notre pays, des métiers exigeants, et une grande solidarité, une grande fraternité d’arme, dans nos régiments. »
Le 17e RGP, un régiment « bien dans sa peau »
Le général découvre un régiment « bien dans sa peau », comme il le dit lui-même. Un régiment exigeant, fidèle à l’esprit parachutiste, ancré dans sa ville et dans son département. Montauban et le 17e fêtent leurs noces d’or, cinquante ans d’histoire commune qui ont façonné un lien rare entre une unité et un territoire.
Et le Tarn-et-Garonne ne s’arrête pas là : le lendemain, le général poursuit sa tournée en visitant le 31e Régiment du Génie à Castelsarrasin, preuve qu’ici, le Génie tient une place singulière — deux régiments, deux cultures, une même Arme tournée vers l’avenir.
Comprendre vite, agir juste, s’adapter en permanence.
Au terme de l’entretien, une conviction se dégage : le Génie entre dans une période charnière, où son rôle évolue aussi vite que les menaces. L’enjeu, pour l’École du Génie comme pour les unités, est désormais de préparer des soldats et des cadres capables de tenir quand tout devient incertain, de comprendre ce qui change avant même que les doctrines ne soient écrites, et d’affronter des situations qui ne ressemblent ni aux conflits passés ni aux scénarios prévus.
Le général de Richoufftz n’enrobe pas cette réalité. Il trace une ligne, simplement : préparer sans savoir exactement à quoi ; former sans illusion ; adapter sans cesse. Un discours clair, droit, sans emphase — et c’est peut-être là que se joue l’essentiel : l’armée française n’a plus le luxe de se préparer à ce qu’elle connaît. Elle doit se préparer à ce qu’elle ignore encore.
Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook.