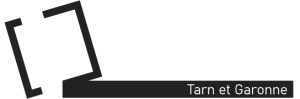Dans l’enceinte du 9ᵉ Régiment de Soutien Aéromobile (RSAM), niché à Montauban, le vacarme des bottes s’apaise à l’approche du chenil. Ici, les ordres se murmurent, les regards se croisent, les gestes s’accordent. Car dans ce groupe bien particulier, les militaires ne travaillent pas seuls : à leurs côtés, dix chiens d’intervention, dressés, entraînés et investis d’une mission aussi stratégique que discrète.
Dans un monde où l’humain seul ne peut tout percevoir, le flair, la réactivité et l’instinct du chien deviennent des armes inestimables. Leur mission ? Détecter les intrusions dans l’enceinte militaire, pister les mouvements suspects, alerter sans bruit. Le jour comme la nuit, ils patrouillent en silence, premières sentinelles d’un dispositif de sécurité dont ils sont les pièces maîtresses. En opération extérieure, ils sont parfois déployés pour la détection d’explosifs, la recherche de personnes dissimulées ou la sécurisation de zones sensibles. Polyvalents, silencieux, redoutablement efficaces, ils sont une force d’appoint nécessaire, capable de faire économiser dix hommes sur le terrain, l’équivalent d’un groupe de combat.
Accueilli par l’adjudant Pierre, responsable du chenil, et le sergent Pauline qui prend peu à peu sa relève, on pénètre dans un monde à part : exigeant, physique, souvent méconnu, mais porté par une passion viscérale pour le travail bien fait et la complicité avec le vivant, où chaque geste est précis, chaque relation singulière.
Un groupe cynotechnique structuré autour du binôme
Le groupe cynotechnique du 9ᵉ RSAM se compose d’un sous-officier, de six militaires du rang et de dix chiens — principalement des bergers belges malinois, mais aussi un berger hollandais et quelques bergers allemands. L’organisation repose sur un principe fondamental : l’unité du binôme. « Lorsqu’un militaire est muté, il part avec son chien » indique le sergent Pauline. Cela garantit la continuité du lien, la stabilité émotionnelle de l’animal et la fluidité des missions.
Lorsque cette règle ne peut s’appliquer, notamment en cas de réforme ou de nécessité de formation, une passation s’opère. Ainsi, Paco, malinois expérimenté, a été confié à une jeune recrue. Un moment particulier pour l’adjudant Pierre, qui l’avait formé depuis son plus jeune âge : « C’est un chien stable, joueur, très bon pour former les jeunes », dit-il. Derrière la neutralité de la décision perce une émotion discrète : « C’est le métier, c’est comme cela. »
Sélection rigoureuse des chiens : qualités physiques et comportementales essentielles
Les chiens sont sélectionnés pour leur robustesse physique, leur équilibre psychique et leur appétence au jeu, moteur essentiel du dressage. Les élevages partenaires sont rigoureusement choisis, en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, pour garantir des lignées adaptées au travail militaire. « Comme nous, ils doivent être complets. Il faut un chien stable, sociable, rustique, qui ne craint pas le bruit des bâches, des détonations. Et il faut aussi qu’il aime jouer, chercher, être combattif, mais avec équilibre », résume l’adjudant Pierre.
Entraînement quotidien : discipline, obéissance et complicité renforcée
Être maître-chien, c’est avant tout former un binôme. « On réfléchit à l’association du caractère entre le maître et le chien. C’est ce qui fait la réussite de l’éducation et de la mission », insiste l’adjudant Pierre. Cette compatibilité est primordiale, tant pour le travail que pour la sécurité du duo.
Chaque journée commence par du sport pour les maîtres. Suit un programme structuré de dressage et d’exercices techniques. L’obéissance, la suite au pied qui permet au militaire d’évoluer en mission avec son arme tout en gardant le contrôle du chien sans avoir à le tenir physiquement, les positions à distance, l’immobilité, les sauts, la quête croisée avec sortie de cache sont autant de séquences travaillées au cordeau. Le mordant, quant à lui, mobilise une autre dimension : confrontation, self-control, gestion de la pression.
Techniques et exercices opérationnels adaptés aux missions
Lors de notre visite, Paco, a exécuté sous la conduite d’une jeune militaire une série fluide et précise de mouvements : positionnement à distance, quête olfactive, sortie de cache, le tout dans un silence absolu, révélant une complicité naissante, mais déjà solide.
Ty Boy, binôme du sergent Pauline, a quant à lui réalisé un exercice de mordant incluant les phases bâton, revolver, et « pas fuyant » — manœuvre complexe où le chien doit intercepter une cible tentant de fuir. Tout cela dans un climat de confiance où chaque regard, chaque ordre, chaque geste compte.
Des exercices de nuit sont régulièrement organisés pour renforcer les capacités de détection dans des conditions opérationnelles réalistes, notamment la recherche d’intrus sur le site. La discipline est constante, mais l’adaptabilité est permanente.












Contraintes physiques et rigueur professionnelle
Le chenil rénové en 2022 offre désormais des conditions de travail optimales : vestiaires canins, parcs d’entraînement, environnement varié pour la désensibilisation. Mais derrière ce confort apparent, la réalité reste exigeante. Les maîtres-chiens vivent souvent sur place. En période de garde, ils dorment au régiment, assurent l’entretien du site, la surveillance des animaux, leur alimentation, et bien sûr leur bien-être.
« On est ici plus souvent que chez nous », glisse l’adjudant Pierre. Les chiens sont suivis par des vétérinaires, bénéficient d’une alimentation adaptée et d’un cadre conçu pour leur épanouissement. Mais le métier reste rude. « Il faut de la rusticité, une certaine endurance physique et mentale. On se fait parfois rentrer dedans par des chiens de 40 kg, ce n’est pas un travail pour les hésitants » souligne le sergent Pauline. En effet, le métier est celui aussi d’homme d’attaque. Enfiler un costume est un geste quotidien permettant à chaque binôme de s’entrainer quel que soit le temps. Il faut être disponible, endurant, humble. Et passionné. « C’est un métier de passion. On travaille avec du vivant et il y a énormément de contraintes qui s’accumulent aux contraintes de la mission et du quotidien d’un soldat. C’est éprouvant et dur sur le long terme », insiste l’adjudant.« Celui qui n’est pas passionné aura des difficultés à assurer toutes les contraintes de la spécialité. »
Une retraite méritée
Autour de l’âge de huit ans, les chiens quittent le service. S’ils sont aptes à vivre en famille, ils sont confiés à leur maître ou placés en adoption après évaluation comportementale. « Pas de concours, pas de travail, mais une vraie retraite », résume sobrement l’adjudant Pierre.
Formation spécifique des maîtres-chiens : un apprentissage militaire exigeant
« C’est un métier ingrat, pas ou peu reconnu », dit sobrement le sergent Pauline. Et pourtant, dans l’ombre des clôtures, dans les silences tactiques, les maîtres-chiens et leurs compagnons incarnent une forme d’excellence discrète. Ils ne brillent pas par les médailles, mais par une rigueur quotidienne, une implication totale, un respect profond du vivant.
La formation est exigeante : tronc commun militaire, stage d’infanterie, spécialisation cynotechnique à Biscarrosse, conduite, dressage, mordant. « Il faut environ un an pour être pleinement opérationnel », précise le sergent Pauline. Les chiens, eux, sont prêts en 6 à 12 mois selon le niveau (patrouille, reconnaissance, intervention). « Comme les enfants, le chien apprend vite les bêtises… le reste prend plus de temps », note l’adjudant Pierre, amusé.
Un engagement discret mais indispensable
Dans un monde militaire où tout est souvent rigueur, procédure et hiérarchie, les maîtres-chiens du 9ᵉ RSAM tracent leur voie avec une forme de discrétion presque artisanale. À l’écart des projecteurs, ils façonnent, jour après jour, cette complicité entre l’homme et l’animal, où chaque ordre murmuré, chaque geste répété, scelle un pacte de confiance.
Ce métier impose une loyauté constante, une capacité d’adaptation rare, une autonomie et une rigueur sans faille. Mais il offre en retour une liberté inestimables : celle de tisser un lien unique avec un être vivant, de progresser ensemble, et de bâtir, dans le silence d’un chenil ou l’urgence d’une intervention, une alchimie faite de respect, de confiance et d’engagement.
Au sein du 9ᵉ RSAM, entre les aboiements et les regards complices, se dessine une autre idée du service : celle d’un engagement total, partagé, humble… mais essentiel.
Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook