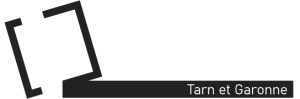Vendredi matin, c’est un préfet à la fois ferme et pédagogue qui s’est adressé à la presse dans les salons de la préfecture de Montauban. Vincent Roberti, accompagné de Bénédicte Martineau, sous-préfète, et Morgan Tellier, Président de la Communauté de Communes Quercy vert–Aveyron, a tenu à faire toute la lumière sur la réquisition controversée d’un terrain agricole privé à Saint-Étienne-de-Tulmont, destinée à l’installation provisoire d’une aire de grand passage pour les gens du voyage. Une mesure exceptionnelle, selon lui, mais rendue inévitable par les carences structurelles et l’absence de consensus politique local.
« Il y a eu beaucoup de confusion, et je souhaitais clarifier les choses », a introduit le préfet. « On ne parle pas ici d’une aire d’accueil pérenne, mais bien d’une aire de grand passage. C’est un dispositif temporaire, destiné à permettre le stationnement de groupes itinérants en transit, notamment durant l’été. »
Réquisition d’un terrain à Saint-Étienne-de-Tulmont : une mesure légale non une initiative locale
Depuis la loi du 5 juillet 2000, modifiée en 2018, l’accueil des gens du voyage relève d’une responsabilité partagée entre l’État, les départements et les intercommunalités. Et pourtant, le département de Tarn-et-Garonne ne s’était pas doté d’un schéma d’accueil depuis 2019, laissant la voie libre à des installations sauvages impossibles à expulser faute de conformité au cadre légal.
« En 2023, sans schéma d’accueil, on n’a rien pu faire face aux stationnements illicites », a déploré Vincent Roberti. « Or, pour agir, il faut d’abord être dans la légalité. »
Conscient de ce vide juridique, le préfet, en concertation avec Michel Weill, président du Conseil départemental, a relancé le processus dès son arrivée. Le fruit de ce travail s’est concrétisé le 12 mars 2024 avec l’adoption d’un nouveau schéma prévoyant la création d’une à deux aires de grand passage dans le département. « L’Aveyron en a trois. Nous, aucune. Il s’agissait simplement de rattraper notre retard et d’entrer dans le cadre légal », a-t-il martelé.
Réquisition : un choix coûteux, faute de consensus
Malgré la validation du schéma, aucune commune n’a proposé de site adapté pour la saison. Le préfet a donc été contraint de recourir à la réquisition. Le terrain choisi, à proximité d’Albias et de l’autoroute A20, présente les caractéristiques techniques exigées : quatre hectares, proximité des réseaux d’eau et d’électricité, et accessibilité aux grands axes.
« La réquisition, ce n’est pas un plaisir. C’est une nécessité. Nous avons étudié une douzaine de sites, à Castelsarrasin, Montauban, Caussade… Aucun n’a été retenu. Il faut que les uns les autres entendent que la réquisition, c’est la dernière modalité quand tout a échoué avant. »
Mais le coût est lourd : l’agriculteur propriétaire, qui venait de labourer pour cultiver de la Luzerne, sera indemnisé pour sa perte de récolte et les dégâts liés aux travaux d’aménagement. En 2024, l’aire provisoire de Montbartier avait coûté 120 000 € (dont 80 % financés par l’État). « Une solution transitoire bien plus chère qu’une aire pérenne », a souligné le préfet, plaidant pour un investissement durable.
Il a aussi rappelé que « l’argent de l’État, ce n’est pas le mien, c’est celui du contribuable. L’argent de la communauté de communes, ce n’est pas celui de Monsieur Tellier non plus. Donc, on ne peut pas demander au contribuable de payer chaque année une facture qui normalement devrait être étalée sur 10 ou 15 ans. Là, on est déjà perdant ».
L’ordre public en jeu : comment la réquisition évite des installations sauvages
Au cœur de l’argumentaire du préfet se trouve la question de l’ordre public.
« Certains m’accusent de semer le désordre. C’est tout le contraire. Pour être ferme, il faut d’abord respecter la loi. Sans terrain prévu, aucune expulsion n’est possible sans décision judiciaire, et cela peut prendre trois semaines. »
Vincent Roberti, préfet de Tarn-et-Garonne
L’exemple de Montbartier, en 2024, démontre l’utilité d’une telle aire : seulement quatre groupes accueillis en vingt semaines, pour une occupation cumulée de sept semaines uniquement. « Le reste du temps, l’aire était vide. Mais elle a rempli son rôle », insiste-t-il.
Il précise : « J’ai dû agir par nécessité et j’ai agi dans le cadre du maintien de l’ordre public. Parce que sans aire, on ne peut rien faire ou quasiment rien faire. C’est la désorganisation totale. »
La gestion des aires de grand passage : le rôle des associations spécialisées
La gestion des aires de grand passage est assurée par des associations spécialisées, à l’image de L’Hacienda, en charge du site de Montbartier. Ces structures jouent un rôle central : elles assurent la médiation, perçoivent les redevances, contrôlent les consommations d’eau et d’électricité, et veillent à la propreté des lieux. Elles disposent également de procédures strictes pour garantir le règlement des frais : « L’association conserve les cartes d’identité des occupants pendant leur séjour, et ne les restitue qu’une fois les factures acquittées », précise le préfet.
Contrairement à certaines idées reçues, ces aires ne sont pas gratuites. Une redevance est systématiquement exigée, reversée aux communautés de communes. « Cela permet de compenser une partie des coûts de fonctionnement, et d’alléger la charge financière qui pèse sur les collectivités locales », explique-t-il.
Conscient des tensions que peut engendrer l’accueil de ces aires sur un territoire donné, Vincent Roberti milite pour une mutualisation intercommunale. « Il n’est pas acceptable qu’une seule commune supporte l’ensemble des contraintes. À Montbartier, dix EPCI ont été sollicités. Certains, comme Caussade ou Quercy vert-Aveyron, ont accepté. D’autres, en revanche, n’ont pas encore répondu. Les discussions se poursuivent. » Le préfet insiste sur l’enjeu d’équité et sur la nécessité d’un effort collectif, à la mesure des responsabilités partagées par les territoires.
Une démarche assumée par Morgan Tellier
Interrogé sur sa réaction à l’annonce de la réquisition, le président de la communauté de communes Quercy vert-Aveyron, Monsieur Tellier, a exprimé un soutien mesuré, mais loyal :
« Passé la surprise, nous avons le devoir de faire respecter l’État de droit. On se doit de le faire respecter de manière consensuelle, de manière réfléchie, concertée. On va assumer ce que l’on doit assumer. »
Morgan Tellier, Président de la Communauté de Communes Quercy vert–Aveyron
Le préfet a tenu à souligner que les maires ne sont jamais pris de court. « Je vais les voir, j’explique, nous cherchons le terrain le moins pénalisant. Mais je comprends leurs difficultés, surtout en période préélectorale. »
Un appel au réalisme
Vincent Roberti appelle à dépasser les fantasmes associés à l’installation des gens du voyage. « Ce ne sont pas des installations à demeure. Ce sont des familles françaises en transit, souvent vers des rassemblements religieux ou culturels, comme Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils s’arrêtent une ou deux semaines, et repartent. »
Il alerte aussi sur les risques liés à l’inaction : « Je ne veux plus voir des élus se placer devant les caravanes pour bloquer une installation. Cela génère des tensions, des risques d’accidents. La réquisition est une garantie d’ordre public. »
Vers une solution durable pour 2026 ?
Le préfet conclut sur une volonté de sortir de la logique de l’urgence en exprimant l’espoir qu’un terrain définitif puisse être identifié, permettant d’éviter de nouvelles réquisitions et d’assurer une gestion apaisée, conforme au droit.
« Ce que je souhaite, c’est un terrain pérenne, pensé, aménagé, accepté. Une fois en place, le problème n’en est plus un. Les habitants de Saint-Étienne-de-Tulmont, en octobre, constateront je l’espère, qu’ils n’auront pas été autant dérangés qu’ils le redoutaient. »
Confiant dans la capacité des collectivités à surmonter les réticences initiales, il conclut : « Une fois qu’on aura réglé ce sujet, ce ne sera plus un sujet. »
En France, il faut savoir que 150 000 personnes vivent en résidence mobile, et que la liberté de circulation est un droit constitutionnel. Dès lors, l’aménagement d’aires de grand passage relève moins d’un choix que d’un devoir, permettant à l’État comme aux collectivités de garantir l’équilibre entre les droits individuels et la préservation de l’ordre public.
Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook.