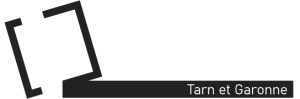Sur la place fraîchement rebaptisée, un silence inhabituel enveloppe la foule. Ce vendredi matin, au cœur de Moissac, quelque chose d’inédit se joue. Anciens combattants, harkis, pieds-noirs, descendants et élus sont réunis pour une cérémonie qui dépasse le cadre habituel des commémorations : l’inauguration d’une stèle en hommage aux morts d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.
« 1954-1962 – GUERRE – Algérie, Maroc, Tunisie – Hommage à nos morts. »
La gravure est simple, solennelle. Elle se dresse désormais au centre de ce qui s’appelle officiellement la Place des Anciens combattants d’Afrique du Nord — nouveau nom voté par le conseil municipal, en remplacement de l’ancienne Place du 19 mars 1962.
Une initiative locale et un travail de longue haleine
À l’origine, le projet était porté par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) du canton de Moissac, représentée par Gérard Lannes, son président. Son souhait : faire vivre la mémoire des jeunes appelés envoyés en Afrique du Nord. Mais plutôt qu’une initiative exclusive, la municipalité a proposé une démarche partagée. Le maire, Romain Lopez, a posé une condition : « Ce monument doit rassembler. »
C’est ainsi qu’est né un projet singulier, fruit d’un dialogue entre la FNACA, le Cercle algérianiste, l’association Générations Harkis et la ville. Un accord fragile, mais historique, tant les blessures du passé restaient vives.


Des paroles fortes, longtemps contenues
Pour la première fois, on ne choisit pas une mémoire contre une autre. On les accueille toutes. Au pied de la stèle, les discours se succèdent.
« Ce fut un pseudo, cessez-le-feu. Ce ne fut jamais un, cessez le sang. » — Jaqueline Curato
Jacqueline Curato, présidente du Cercle algérianiste, prend la parole avec une émotion non contenue. Elle rappelle les souffrances subies après les accords d’Évian, les massacres d’Oran, l’exode, l’abandon des harkis : « Vous comprendrez donc la sainte colère qui nous prend, à chaque fois que nous voyons cette inscription, 19 mars 1962. Pourquoi cette colère ? Parce que le 19 mars 1962, ce fut un pseudo, cessez-le-feu. Ce ne fut jamais un, cessez le sang. »
Et de rappeler, les yeux embués, les colonnes de camions militaires qu’elle observait, enfant, depuis le balcon de sa grand-mère à Philippeville : « les convois des militaires revenant d’opérations, les files de GMC, avec ses combattants blessés, assis de chaque côté, et au milieu, les corps de leurs camarades tombés au combat. »
« Vous rétablissez une vérité nationale, historique. » — Djafour Mohamed
Puis ce fut au tour de Mohamed Djafour, président de l’association Générations Harkis, de prendre la parole. Dans un silence attentif, sa voix porta une mémoire douloureuse, longtemps reléguée au second plan et une gratitude sincère. Devant l’assemblée réunie à Moissac, il a salué le geste fort de la municipalité : « À l’échelle de votre commune, vous rétablissez une vérité nationale, historique », a-t-il déclaré, remerciant les élus pour leur engagement dans un travail de reconnaissance trop longtemps différé. En son nom et en celui des descendants de harkis, il a exprimé sa reconnaissance à la FNACA du canton de Moissac pour avoir œuvré à cette « volonté commune d’apaisement », malgré les plaies encore vives d’une guerre fratricide. Sans détour, il a évoqué la trahison ressentie par ceux qui, désarmés, furent abandonnés aux mains du FLN, rappelant que « cent cinquante mille Harkis et leurs familles furent massacrés, égorgés, émasculés sur la place publique, aux yeux du monde entier ». Sa voix s’est faite plus douce, mais non moins marquée par l’émotion lorsqu’il a évoqué « nos amis pieds-noirs qui n’ont pas eu d’autre choix que la valise et les cercueils ». Un hommage lucide, douloureux.
« Pas encore majeurs, mais en âge de tenir un fusil » — Gérard Lannes
Le témoignage de Gérard Lannes, représentant de la FNACA du canton de Moissac, est venu, lui, rappeler la jeunesse sacrifiée des appelés du contingent. Il évoque ces jeunes Français partis en Algérie à vingt ans à peine, « pas encore majeurs, mais en âge de tenir un fusil », envoyés en patrouille, confrontés à la guérilla, « avec trois semaines de permission sur deux ans de service pour certains. » Il a salué une initiative locale financée entièrement par la mairie, qu’il voit comme un geste d’unité et de reconnaissance.





Le discours du maire : mémoire plurielle, réconciliation fragile
Le discours du maire de Moissac, Romain Lopez, a offert l’un des moments les plus intenses de la cérémonie. Citant Albert Camus — « La tendresse de ce pays est bouleversante et furtive » —, il a convoqué l’âme de l’Algérie à travers les figures d’Ahmed, musulman né à Alger, d’Antonio, espagnol exilé à Oran, et de Michel, appelé français passé par l’Algérie sans y être né. Trois hommes, trois parcours, un même enracinement. « Tous ont laissé une part de leur chair en terre algérienne ; cette chair, c’est leur descendance », a-t-il dit, évoquant les héritiers directs de cette histoire complexe : anciens combattants, harkis, pieds-noirs et leurs enfants. Le maire a dénoncé les « subterfuges mémoriels » ayant dressé les victimes les unes contre les autres et salué la volonté partagée de dépasser les blessures : « Dans tout conflit, la souffrance ne devrait jamais être exploitée pour diviser. »
« Vos morts qui sont tous les nôtres. »
Dans un passage particulièrement fort, il a rappelé que l’unité nationale exige des sacrifices, citant à nouveau Camus pour dire que l’Algérie fut pour beaucoup une terre d’énergie, de création, de bonheur partagé, malgré les douleurs. Et de conclure : « Si hier la douleur vous unissait, aujourd’hui, ici à Moissac, le bonheur vous unit. Ce bonheur simple, mais ô combien important : celui d’honorer chacun de vos morts dans la paix des mémoires. Vos morts qui sont tous les nôtres. » Un discours d’équilibre, à la fois solennel et intime, salué par l’ensemble des participants.
Des récits personnels, en marge de l’officiel
Dans la foule, certains mots se murmurent à mi-voix, entre deux silences. Au-delà des micros, d’autres récits affleuraient, portés par ceux dont la mémoire n’a pas toujours eu droit de cité.
Jean-Michel, Moissagais, a tenu à être présent. Il raconte sans fard : « J’avais sept ans. Mon instituteur a été égorgé. Dès fois, je rentrais seul de l’école, je me cachais derrière les piliers en béton de la place quand ça tirait. Et pourtant… La vie était belle, là-bas, on se baignait à Fort-de-l’Eau. »
Plus loin, Mohamed Djafour, président de Générations Harkis, partage à chaud ses impressions :
« On ne nous a pas rapatrié, nous nous sommes évadés en 1968. Cette stèle, c’est une victoire sur le mensonge et le déni de nos autorités qui ont bafoué cette vérité. »
Une cérémonie rare, appelée à essaimer
Pour Quentin Lamotte, conseiller régional, cette cérémonie porte un message fort : « L’esprit de concorde a été respecté. Nous n’avons pas voulu attiser les divisions, mais créer un lieu de mémoire qui rassemble. » Un message repris par plusieurs intervenants, qui espèrent désormais que cet exemple local inspire d’autres communes.
Tous ont reconnu le rôle central de la municipalité dans cette initiative, et en particulier celui du maire Romain Lopez, salué pour avoir su dépasser les fractures historiques afin de proposer un chemin d’unité.
Une place, une pierre, une possibilité
Le public se disperse lentement. Les drapeaux s’éloignent. La stèle, elle, demeure. Sobre. Inaltérable. Elle ne referme pas les blessures. Mais elle dit, en silence, qu’une parole commune est possible.
Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook.